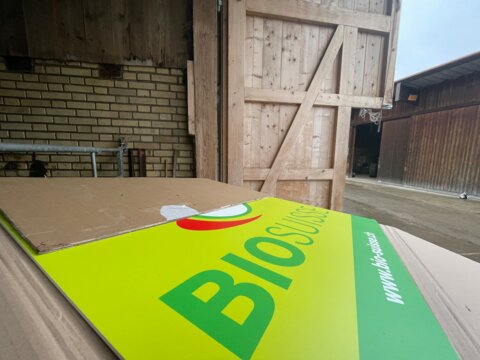En bref
- Les chef·fes d’exploitation ont l’obligation légale d’offrir des conditions de travail sûres et de prendre des mesures de protection.
- La sécurité au travail ne fonctionne que si elle est intégrée à la culture d’entreprise et systématiquement appliquée.
- Des listes de contrôle, des avis externes et une procédure structurée permettent de réduire les risques.
En Suisse, toutes les deux semaines environ, une personne décède dans un accident agricole. Outre la souffrance qu’un tel événement engendre au sein de la famille et de l’équipe, c’est toute une exploitation qui risque de chanceler si personne n’est en mesure d’assumer les tâches et les responsabilités de la personne accidentée, ou ne dispose des compétences nécessaires pour poursuivre l’activité. Il est donc essentiel d’avoir une stratégie d’urgence pour ce cas de figure, mais aussi et surtout de mettre en place des mesures de prévention ad hoc afin que ce genre d’événement n’arrive pas.
Regarder attentivement pour assurer sa sécurité
Si chaque exploitation agricole est unique, les causes d’accident les plus fréquentes dans la branche sont bien connues (cf. graphique).
Les prévenir, c’est examiner précisément la situation de son exploitation pour en identifier les éventuels dangers. L’important n’est pas d’examiner ce qui a bien fonctionné jusque-là, mais de regarder là où, dans une situation similaire, les choses ont mal tourné.
Du danger à la mesure de sécurité
Une fois le danger identifié se pose la question du risque et de la priorité. Tous les dangers potentiels n’exigent pas une action immédiate. Aussi les risques sont-ils évalués selon leur probabilité et leur gravité au moyen d’une matrice. La prévention des accidents consiste à identifier les risques mais aussi à les gérer correctement, grâce à des solutions efficaces et durables. Le fameux principe STOP est utilisé lors de la planification des mesures de protection.
Les trois étapes principales
1 Reconnaître les risques
- Quiconque répète quotidiennement les mêmes gestes ne voit souvent plus les dangers. Pour remédier à ce problème, plusieurs moyens existent :
- les listes de contrôle aident à procéder de manière structurée ;
- un regard extérieur, notamment au travers d’échanges avec des collègues de travail, permet d’avoir un autre point de vue ;
- un contrôle de sécurité par un·e spécialiste fournit une évaluation objective et professionnelle ;
- les retours d’expérience de la famille et du personnel sont précieux.
2 Evaluer les risques
Les mesures doivent être appliquées en priorité là où les risques sont les plus élevés. Les situations aux conséquences graves qui sont fréquentes sont considérées particulièrement critiques (zone foncée).
En mettant en œuvre le principe STOP, l’objectif est de faire passer la situation autant que possible de la zone sombre à la zone claire.
3 Prendre des mesures selon le principe STOP
- Substitution (remplacement). Le risque est écarté ou remplacé par une alternative moins dangereuse. Exemple : recourir à l’insémination artificielle plutôt qu’à un taureau reproducteur
- Technique. Exemple : poser des garde-corps près de la trappe à foin.
- Organisation. Les processus de travail sont organisés de manière sûre. Exemple : réglementer la maintenance et l’entretien des équipements de travail, des machines, des installations et des bâtiments.
- Personne. Des équipements de protection individuelle sont utilisés et l’ensemble de l’équipe adopte un comportement approprié. Exemple : attacher sa ceinture de sécurité sur le tracteur.
L’erreur humaine est une des principales causes d’accidents. Les mesures aux niveaux Substitution (remplacement) et Technique sont les plus efficaces car elles réduisent le risque indépendamment du comportement de la personne. Les mesures organisationnelles et personnelles n’interviennent que lorsqu’aucune autre solution n’est possible ou pour limiter les risques résiduels.
La sécurité n’est pas négociable
La sécurité ne relève pas de la sphère privée : il s’agit d’une responsabilité à part entière des chef·fes d’exploitation. Lorsque ces derniers emploient des apprenti·es ou du personnel non familial, ils ont l’obligation légale de mettre en œuvre une stratégie de sécurité selon la directive CFST 6508 ; le respect de cet impératif implique d’instaurer des conditions de travail sûres, de réduire les risques et de prendre des mesures de protection de manière systématique.
Ignorer les risques, c’est se mettre soi-même et les autres inutilement en danger.
De leur côté, les collaborateurs·trices doivent respecter les directives de sécurité de l’exploitation. Mais que faire en cas de non-respect des règles de sécurité ? L’ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) stipule clairement que la sécurité n’est pas négociable. Tout manquement peut avoir de graves conséquences, pour l’entreprise mais surtout pour les personnes directement ou indirectement concernées. Etablir des règles ne suffit donc pas : celles-ci doivent être communiquées, enseignées par l’exemple et mises en œuvre. Car la sécurité au travail ne fonctionne que si elle fait partie intégrante de la culture d’entreprise.
Loi sur l’assurance-accidents et collaboration du personnel
Les exploitations agricoles soumises à la loi sur l’assurance-accidents (LAA) ont l’obligation de mettre en place des mesures de prévention, ce qui implique de respecter notamment les impératifs suivants :
- assurance-accidents obligatoire pour les collaborateur·trices ;
- appel à des spécialistes de la sécurité au travail (MSST), conformément à la directive CFST 6508, et mise en œuvre une stratégie de sécurité ad hoc (p. ex. la solution de la branche agricole agriTOP) ;
- organisation et entretien de postes ainsi que d’équipements de travail sûrs ;
- instruction et formation des collaborateur·trices ;
- documentation de la mise en œuvre.
www.bul.ch ➞ Agritop ➞ Concept de sécurité