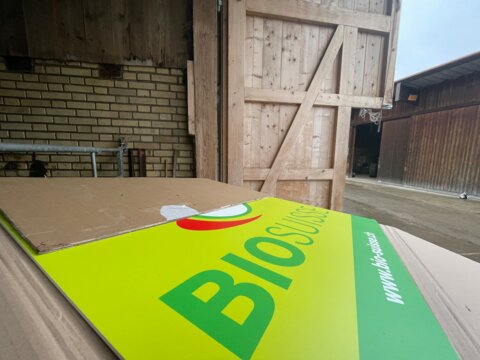La période de Carnaval a gagné les Rhodes-Intérieures, marquées par le catholicisme. « Les carnavaliers sont de retour, c’est presque comme autrefois », se réjouit une Appenzelloise âgée. Pour le « Schmutziger Donnerstag » (soit le jeudi gras, le 27 février 2025) tout comme le samedi de Carnaval (« Faschnedsamschtig »), les « Botzerössli » et les tambours forment l’avant-garde des cortèges d’enfants et du grand défilé de Carnaval d’Appenzell. A l’inverse d’un défilé militaire, rares sont ceux qui marchent au pas. Au son joyeux et carnavalesque des tambours, les petits et les grands chevaux gambadent sans un bruit de sabot : les participantes et les participants portent des semelles en caoutchouc silencieuses. Mais que sont les « Botzerössli » exactement ? Ces chevaux appenzellois ne sont autres que des chevaux en bois de pin. Les cavaliers·ères, vêtus à l’origine d’anciens uniformes militaires bleus et désormais aussi d’uniformes de pompiers, camouflent leurs jambes derrière un tissu coloré. Ils portent les chevaux factices à l’aide d’un harnais en lanières en plastique ou en cuir. Un trou découpé dans le dos des « petits chevaux », fabriqués en trois couches de pin, permet de laisser passer les bustes des cavaliers·ères. Cela fait bien longtemps que cette « cavalerie » n’est plus exclusivement masculine.
Les chevaux en bois sont fabriqués en bois de pin local.
Du vrai crin de cheval
L’association organisatrice du Carnaval d’Appenzell met un point d’honneur à conserver cette tradition bien particulière. Le charpentier Baptist Neff fabrique parfois ce type de « Botzerössli » dans son entreprise. Ces derniers sont construits en bois de pin local et en partie avec du véritable crin issu des queues de chevaux. La fabrication d’un tel cheval coûte, selon la taille, le matériel et l’exécution, environ 1000 francs et nécessite un à deux jours de travail. Baptist Neff dirige la « cavalerie », qui compte jusqu’à trente adultes, jeunes et enfants. Son épouse, Vreni, s’occupe principalement du maquillage des cavaliers·ères. Elle trace sur leur visage de grandes moustaches noires, quelques taches de rousseur et des joues rouges.
Font aussi partie de l’association les « Appezölle Trömmelibuebe und -meedle » (jeunes joueurs·euses de tambours d’Appenzell) dirigés par l’artisan et « Obertrommler » Adalbert Fässler, qui participe activement depuis plus de 40 ans au maintien de cette tradition. Il apprend aux petits et aux grands tous les talents nécessaires pour se produire comme il se doit en public, tandis que son frère Maurus veille à ce que tout·es les participant·es portent les costumes adaptés. Adalbert fabrique aussi depuis plusieurs années des petits chevaux en bois, comme l’ont fait ses aïeux autrefois.
« Galopade » dans le village
Pleine d’enthousiasme, la famille de Baptist et Vreni Neff-Inauen a participé tôt avec ses enfants au « carnaval des petits chevaux ». Des ami·es les ont rejoints peu à peu et aujourd’hui, c’est toute une troupe qui se rend ensemble au coup d’envoi. Baptist Neff (accompagné désormais de son fils Lukas, né en 1996) conduit le groupe depuis plus de 20 ans : « Ça s’est fait ainsi car pendant les journées de carnaval, nous avons suffisamment de place dans l’écurie pour tous les chevaux. C’est bien plus drôle quand on gambade en groupe dans le village », assure le charpentier. Et son épouse Vreni de compléter : « C’est aussi pour cela que nous avons plaisir à perpétuer cette coutume et que nous nous amusons beaucoup ensemble pendant les jours de carnaval. »
Les « Botzerössli » ont besoin de boire
Hommes et femmes trottent et dansent avec les enfants dans les rues d’Appenzell. Beaucoup d’entre eux font les fous, courent ici et là, très indisciplinés. Sur leur parcours, les petits chevaux font une halte à la grande fontaine du village. De temps en temps, ils ont besoin de boire, c’est pourquoi les cavaliers·ères s’arrêtent aux diverses fontaines. Dans le village d’Appenzell qui compte quelque 5700 habitant·es, les fontaines publiques sont nombreuses.
De belles brides doivent être montées et des grelots fixés sur les lanières de cuir latérales. Les « Botzerössli » gambadent et trottinent, faisant tinter joyeusement leurs grelots. Mais les animaux ne sont pas toujours faciles à dompter, et il arrive que cheval et cavalier·ère effraient les passant·es avec leur tempérament fougueux, témoigne un participant. Le public s’émerveille, filme ou photographie cette galopade dynamique, ancestrale et divertissante. Les cavaliers·ères et leur monture posent très volontiers. Ils poussent des hennissements et parfois même un petit yodle. Les cavaliers·ères ne lâchent jamais les rênes en cuir, ferrées avec du laiton. Les langues claquent, et des séries d’onomatopées telles que « hue », « oh la », « brrr » s’ensuivent.
Les professionel·les du tourisme sont naturellement heureux que cette tradition cavalière ait pris toute sa place durant le Carnaval. Parmi eux, le responsable de l’agence Appenzellerland Tourismus AI, qui invite à cette occasion les visiteurs·euses à passer d’agréables moments en pleine nature en profitant de l’air frais d’Appenzell. Et de conclure : « Chönd zonis ! » (venez nous voir un de ces jours !).
Comment est née la tradition des « Botzerössli » ?
La première mention de cette tradition appenzelloise paraît en 1837. A ce sujet, Titus Tobler (1806-1877) écrit dans son dictionnaire du dialecte appenzellois : « Bouffon de carnaval qui, monté sur un cheval de bois, mendie avant chaque carnaval et prononce un discours devant les maisons, entouré d’enfants curieux, dans sa propre tonalité. » En 1939, un pauvre homme se serait promené en Appenzell dans une simple carriole en bois, et aurait déclamé des proverbes pour récolter de l’argent. En 1948, la gazette du carnaval « s Innerrhoder Botze-Rössli » est publiée pour la première fois et c’est sans doute à cette époque que la coutume a été remise au goût du jour. Que signifie « Botze » ? L’historien appenzellois Achilles Weishaupt, décédé en 2022, pensait que le mot avait pour origine les termes de « Butz », « verbutzt », c’est-à-dire quelqu’un qui se déguise.
Le dictionnaire suisse allemand Idiotikon fait état de cette coutume sous l’orthographe « Butze(n)rössli ».