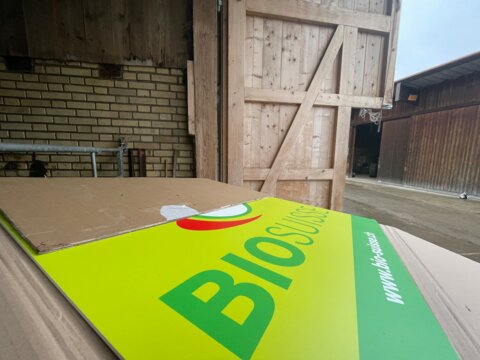Lors de l’aménagement d’une nouvelle prairie de fauche extensive, la priorité est d’atteindre le niveau de qualité écologique 2 (Q2). Cependant, le semis ne laisse aucune place à l’erreur : un aménagement raté est généralement irréversible, même avec un sursemis. Le choix du site, un mélange de semences de qualité et une préparation soignée du sol sont essentiels pour garantir le succès de l’opération concernée. Pourtant, par souci de temps et de coûts, la préparation minutieuse du sol est souvent négligée. Dans le cadre d’un travail de bachelor réalisé à la Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires (BFH-HAFL) pour le compte de Semences UFA, six méthodes courantes de préparation du sol ont été comparées. Parmi celles-ci, trois se sont avérées particulièrement adaptées à l’agriculture.
Des pratiques douces aux pratiques intensives
Dans la première méthode, dite « cultivateur et herse », la couche herbeuse a été retournée à une profondeur de 15 cm à l’aide d’un cultivateur. Le broyage des mottes et le nivellement de la surface ont ensuite été réalisés à plusieurs reprises avec une herse rotative. Par ailleurs, une semaine avant le semis, une légère scarification de la surface du sol a été effectuée.
Dans une parcelle adjacente, la méthode du « Geohobel » a également été testée. De plus en plus prisée pour son impact limité sur le sol, cette machine a d’abord été utilisée à une profondeur de 3 cm. Huit semaines plus tard, un deuxième passage a été effectué, cette fois à une profondeur de 5 cm. Comme pour la première méthode, une légère scarification de la surface a été réalisée à l’aide d’une herse rotative une semaine avant le semis.
Pour la troisième méthode, soit la scarification, le peuplement a subi deux passages agressifs à quatre semaines d’intervalle. Le matériel végétal retiré a ensuite été collecté et évacué. Après ce traitement, le sol présentait une surface entièrement brune et terreuse, laissant très peu de traces du peuplement initial. Il est à noter que la scarification est une technique standard en horticulture, comparable, dans ses effets et son impact, à l’utilisation répétée d’une herse étrille agressive en agriculture, comme lors d’un sursemis.
Enfin, le semis, réalisé au printemps, a été effectué de manière uniforme pour toutes les méthodes, en utilisant le même procédé et le même mélange de semences.
L’ancien peuplement doit faire place au nouveau
La méthode « cultivateur et herse » a obtenu les meilleurs résultats en termes d’établissement des plantes, un an après le semis, suivie de près par la méthode « Geohobel ». En moyenne, 30 des 42 espèces de plantes sauvages semées ont pu être observées. Ces deux méthodes, plus intensives, ont entièrement détruit le peuplement d’origine, tout en faisant remonter à la surface des graines d’adventices annuelles. Ces adventices ont germé rapidement, jouant le rôle de plantes de couverture idéales. Sous leur protection, les fleurs sauvages semées ont pu s’établir dans des conditions optimales avant que la végétation spontanée ne disparaisse avec le gel hivernal. Une coupe de nettoyage réalisée durant l’année de semis a également permis de limiter la concurrence excessive.
En revanche, la méthode « scarification » s’est révélée beaucoup moins efficace : presque aucune des 42 espèces de fleurs et de graminées sauvages semées n’a réussi à s’établir ; le peuplement d’origine n’a été que partiellement détruit et, seulement deux mois après l’intervention, il s’était presque entièrement reconstitué. Les adventices annuelles, pourtant essentielles comme plantes de couverture, n’ont pas eu le temps de se développer, tout comme les nouvelles plantes sauvages semées.
La scarification est comparable à plusieurs passages agressifs avec une herse étrille.
La herse étrille obtient de mauvais résultats
Plus le travail du sol avant le semis est intensif, plus le nombre d’espèces capables de s’établir est élevé. Les meilleures performances sont obtenues avec la charrue ou le cultivateur, suivis de plusieurs passages à la herse. Quant au Geohobel, combiné à la herse, il offre également des résultats satisfaisants. En revanche, une préparation minimale du sol donne de mauvais résultats pour un nouveau semis. La herse étrille, en particulier, ne détruit pas suffisamment le peuplement d’origine, ce qui la rend inadaptée aux semis de fleurs sauvages. Par conséquent, un sursemis est déconseillé dans ce contexte. Quelle que soit la méthode utilisée, les coupes de nettoyage restent indispensables au cours de l’année de semis. Dès que la lumière ne pénètre plus jusqu’au sol, la végétation spontanée doit être coupée et évacuée pour éviter une concurrence excessive.