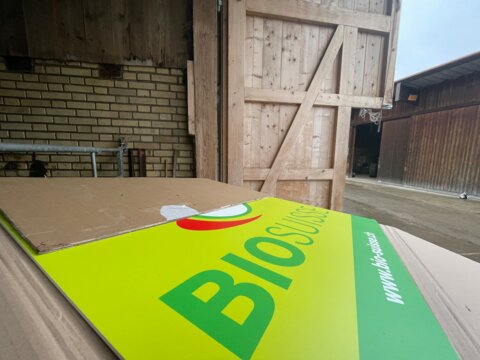En bref
– L’édition génomique est plus précisesque celles du génie génétique des années 1990.
– En désactivant ou en modifiant un gène, il est possible de cultiver de nouvelles plantes utiles sans recourir à du matériel génétique issu d’une autre espèce.
– Le moratoire sur le génie génétique autorise uniquement la recherche fondamentale. Cependant, le débat sur la future réglementation bat son plein.
Que sont les gènes et l’ADN ?
L’ADN (acide désoxyribonucléique) peut être comparé à un « livre de cuisine de la vie », où les gènes (responsables de la transmission du patrimoine génétique) jouent le rôle de recettes. Celles-ci contiennent les instructions nécessaires pour définir les caractéristiques des organismes, comme la couleur des roses ou la composition en protéines du soja. Lorsqu’une plante se reproduit, ses descendants héritent de 50 % des gènes de chaque parent, un processus largement gouverné par le hasard.
Que sont les ciseaux moléculaires ?
La technique des ciseaux moléculaires CRISPR/Cas a été découverte en 1987 au Japon, lors de recherches sur les bactéries. Ce n’est qu’au cours des années 2000 que des chercheurs·euses ont compris que les bactéries disposent de ciseaux de ce type dans leur système immunitaire, ceux-ci permettant de reconnaître et de détruire l’ADN de virus en cas d’attaque répétée. En 2012, les scientifiques Emmanuelle Charpentier (de nationalité française) et Jennifer Doudna (de nationalité américaine) ont étudié comment ce dispositif pouvait être utilisé de manière ciblée pour couper et modifier l’ADN avec précision, ce qui leur ont valu le prix Nobel de chimie.
En quoi l’édition du génome peut-elle être bénéfique pour l’agriculture ?
Les problèmes auxquels font face les agriculteurs·trices sont de plus en plus importants : le dérèglement climatique, avec de longues périodes de sécheresse suivies de fortes pluies, met les surfaces agricoles à rude épreuve ; de moins en moins de substances actives contre les ravageurs et les maladies (notamment celles qui apparaissent en raison du réchauffement climatique) sont disponibles, compliquant la production végétale. De plus, la découverte de nouvelles substances actives pour les produits phytosanitaires se raréfie, et les coûts de développement, souvent très élevés, s’avèrent disproportionnés par rapport à l’utilité de celles-ci. Renforcer une plante pour qu’elle se défende elle-même est une solution plus durable. Car la nature lui a donné, dans une certaine mesure, des moyens pour se protéger. Par exemple, pour se prémunir contre les nuisibles, certaines plantes ont plus de poils sur leur surface ou elles produisent des métabolites secondaires ; d’autres appâtent des auxiliaires en dégageant une odeur attrayante. L’édition du génome permet de modifier des plantes de sorte à développer ces capacités. Pour les maladies fongiques et bactériennes, il existe aussi des mécanismes de défense naturels : certaines anciennes variétés de blé ont une protéine que l`oïdium n’identifie pas comme étant une protéine de blé, reconnaissance dont ce parasite a besoin pour pénétrer dans la plante. Grâce à l’édition génomique, des chercheurs·euses ont introduit cette mutation naturelle dans des variétés modernes de blé.
Avec la sélection conventionnelles, ce changement aurait peut-être aussi été possible, mais il aurait pris plus de temps : développer et commercialiser une nouvelle variété de blé requiert entre 12 et 15 ans ; d’autres traits parfois indésirables sont aussi transmis. L’édition génomique permet d’économiser du temps, de l’argent et des surfaces ainsi que d’accroître la richesse du patrimoine génétique des plantes. Enfin, elle utilise exclusivement des gènes appartenant à une espèce donnée et imite des processus naturels.
Qu’est-ce qui différencie l’édition génomique des anciennes techniques de génie génétiques ?
Les techniques des années 1990, peu spécifiques et ciblées, se fondaient sur l’idée que les plantes cultivées toléreraient un usage accru de produits phytosanitaires. Elles incluaient tant des gènes issus de la même espèce (cisgènes) que des gènes étrangers (transgènes). L’édition génomique modifie uniquement les gènes d’une espèce : elle ne recourt pas au matériel génétique d’espèces tierces. Elle est à la fois plus précise et moins onéreuse que les le génie génétique traditionnel, et ainsi, plus accessible aux sociétés de petites et moyenne taille spécialisées dans la sélection variétale, un secteur de niche. Ses partisan·nes voient dans cette tehcnique une opportunité d’élargir la diversité variétale et de mieux rivaliser avec les acteurs mondiaux qui dominent le marché international des semences. Ils plaident donc pour une procédure d’autorisation adéquate basée sur les risques, qui ne compromettent pas les avantages économiques offerts par cette technique.
Quels bénéfices les anciennes techniques de génie génétique ont-elles apporté en agriculture ?
Les deux produits les plus connus issus de ces techniques sont le maïs Bt transgénique et le soja « Roundup Ready », qui ont tous deux des gènes de bactéries. Le maïs contient une protéine toxique pour les larves de pyrales et de chrysomèles de racines du maïs, qui nuit aussi à certains auxiliaires et probablement à divers organismes du sol. De même, des résistances se sont développées chez les nuisibles. De plus, il crée une grande pression économique sur les exploitations des pays en développement, car les semences sont coûteuses et leur reproduction n’est pas admise, cette interdiction étant strictement contrôlée. En Allemagne, en Autriche et en France, il est interdit de cultiver ce maïs. Quant au « Roundup Ready », un soja résistant au glyphosate (herbicide qui ne détériore pas la plante lors de son application), il a aussi un bilan mitigé : s’il a augmenté les rendements et réduit le temps de travail, il a conduit à un usage accru du glyphosate, péjorant la santé humaine et animale. Dans l’UE, aucun soja génétiquement modifié n’est cultivé, bien qu’il fasse l’objet d’importations.
Les ciseaux moléculaires sont-ils la seule méthode d’édition génomique ?
Le terme « édition génomique » englobe plusieurs méthodes moléculaires modifiant le génome de manière ciblée. La méthode la plus connue et considérée par les scientifiques comme la plus polyvalente est le ciseau moléculaire CRISPR / Cas. D’autres techniques incluent les nucléases à doigts de zinc, le forçage génétique, les nucléases effectrices de type activateur de transcription (TALEN) et les méganucléases. Les approches plus récentes comme la réécriture de base et la réécriture par matrice d’ARN, qui reposent sur la technique des ciseaux moléculaires, sont encore plus précises.
Quelles sont les limites et les risques de l’édition génomique pour l’agriculture ?
Pour éditer le génome avec succès, il faut identifier précisément les gènes cibles. Or cette opération devient compliquée lorsque les caractéristiques visées sont plus complexes, c’est-àdire contrôlés par de multiples gènes (p. ex. rendement) ou impliquent des réseaux de régulation. A cela s’ajoutent les effets épigénétiques (modifications des gènes influencées par l’environnement). Bien que cette méthode soit plus rapide que la sélection conventionnelle, elle requiert que les plantes modifiées soient testées dans divers environnements afin d’en évaluer la plus-value (comme dans la sélection conventionnelle). De plus, comme observé par le passé, une résistance nouvellement développée peut être dépassée par l’adaptation des nuisibles. Il se pose aussi la question de savoir si les plantes modifiées par édition génomique peuvent se croiser avec d’autres plantes dans l’environnement. Comme pour toutes les espèces végétales, les plantes dont le génome a été édité peuvent se croiser avec d’autres plantes dans la nature lorsque celles-ci sont génétiquement et biologiquement compatibles (période de floraison, disponibilité du pollen). Les voix critiques à l’égard de l’édition génomique considèrent cela comme un risque. De plus, elles s’inquiètent que, comme dans le cas des anciennes méthodes, des modifications puissent survenir à des endroits inappropriés du génome, (« mutations hors cible »). Cependant, les avancées offertes par la réécriture de base ou par matrice d’ARN réduisent ce risque. Enfin, la question éthique demeure, car une édition du génome végétal obtenue par sélection naturelle sous l’action des êtres humains sur des millénaires n’est pas perçue de la même manière qu’une intervention directe réalisée en laboratoire
Quelle est la situation juridique de l’édition génomique ?
En Suisse, les technologies CRISPR / Cas est actuellement soumises à la loi sur le génie génétique, entrée en vigueur en 2004 dans le contexte des méthodes de génie génétique utilisées à l’époque. Depuis 2005, un moratoire (soit un ajournement) interdit la culture de plantes OGM dans l’agriculture. Prolongé pour la quatrième fois, ce moratoire est désormais en vigueur jusqu’à fin 2025. En parallèle à cette prolongation, le Parlement a chargé le Conseil fédéral de rédiger un acte législatif visant à instaurer une réglementation basée sur les risques pour l’autorisation des plantes, parties de plantes, semences et autre matériel végétal de multiplication générés à partir de nouvelles méthodes de sélection, à condition qu’aucun matériel génétique étranger à l’espèce n’ait été introduit. Alors qu’un débat public se poursuit sur l’avenir des plantes modifiées par édition génomique, les travaux de recherche fondamentale dans ce domaine se poursuivent. En février 2024, l’OFEV a approuvé un essai en plein champ de culture d’orge modifiée par CRISPR / Cas sur un site protégé.
L’UE propose des assouplissements En 2018, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a décidé que les organismes créés à l’aide de nouvelles techniques telles que CRISPR / Cas doivent être classés comme OGM)et sont donc soumis aux lois européennes strictes sur le génie génétique. Cependant, la Commission européenne a présenté une proposition de réforme visant à introduire des assouplissements pour les plantes développées à l’aide de nouvelles techniques comme CRISPR / Cas.
Plus de souplesse hors de l’UE Les Etats-Unis, la Chine, le Canada, le Brésil et l’Australie adoptent une approche au cas par cas pour les plantes modifiées par édition génomique. En particulier, pour peu que celles-ci n’incluent pas d’ADN étranger à l’espèce (c.-à-d. que seul du matériel génétique provenant d’espèces croisables est utilisé), elles ne sont généralement pas soumises aux strictes réglementations du génie génétique. Elles peuvent ainsi être cultivées, récoltées et commercialisées sans restrictions particulières et aucune obligation d’étiquetage n’est requise dans ces cas.